La prostitution, plaie des civilisations, vieille comme la misère humaine, la prostitution aux aspects multiformes, sévit partout, ostensible ou secrète, mais elle étale parfois, avec une sorte de morne inconscience, ses honteuses purulences, ses laideurs démesurées. Sous le soleil du Midi, le Chapeau Rouge à Toulon, le quartier réservé du Vieux Port à Marseille sont moins attristants peut-être que ne l’était, sous notre ciel gris de Paris, la Monjol — un des lieux les plus fortement marqués par la déchéance humaine.
C’était, entre la barrière du Combat et cette de la Chopinette, en direction des Buttes-Chaumont, une série de ruelles aux masures de plâtras. Il y avait la rue Legrand, qui forme un coude et dont il ne reste que le n° 1, la rue Monjol, primitivement longue de 135 mètres, aujourd’hui réduite à quelques mètres et inhabitée, la tortueuse rue Asselin (actuellement rue Henri-Turot) qui a perdu ses trois étages d’escaliers, mais où l’on retrouve, près du boulevard de la Villette, côté des numéros impairs, des bicoques aux fenêtres disjointes. Vers 1880, l’ancienne rue Péchoin, qui datait de 1840, comme la plupart des voies du coin Monjol, était devenue, après avoir été tracée et alignée, la rue Burnouf.
La Monjol ! Lieu de sinistre réputation – trop justifiée, hélas ! Il me souvient d’y être allé une fois avec un docteur en médecine, hygiéniste et sociologue qui m’avait prié de l’accompagner dans ce quartier de misère physique et de détresse morale.
Nulle part ailleurs, je n’ai ressenti pareille impression de détresse, d’horreur et de dégoût.

Cette sorte de hameau putride était presque entièrement consacré à la prostitution la plus misérable. Des maisons basses, avariées, aux façades de plâtre dartreux, des trottoirs disloqués, des rues en coudes brusques, misérables et malodorantes, à physionomie de repaire ou de coupe-gorge.
Au tournant d’une ruelle lugubre, aux murs troués de portes vétustes, un escalier aux marches craquelées. Au seuil des masures des filles étaient assises, spectrales. D’autres en peignoirs aux couleurs vives, accoudées aux rampes, guettaient avidement le moindre appel du passant. A cette dernière étape de la prostitution, les malheureuses luttent en vain contre les ravages de l’âge et de la maladie qui corrode leurs chairs vénales. Mornes et tristes, visage plâtré et peint, comme certains modèles de Toulouse-Lautrec, ces filles lasses, déjetées, plus ruinées que le fort démantelé qui se dressait autrefois dans ces parages, constituent un triste troupeau, échoué ici par les hasards de la vie. Plus d’une, jadis fille de ferme séduite, ou ouvrière de faubourg victime du chômage, fut à l’origine belle, fraiche, sentimentale. Elles auraient pu devenir des amantes éprises, des ménagères accomplies, des mères de famille sans reproche. Qu’elles aient une part de responsabilité dans leur chute, ou que l’ordre inique des sociétés mérite seul d’être incriminé, le sort de ces malheureuses est pitoyable car elles vivent sans joie d’un triste métier mal rémunéré, dans des réduits au sol écroulé, sans fenêtres, meublés d’un grabat et d’un fourneau.
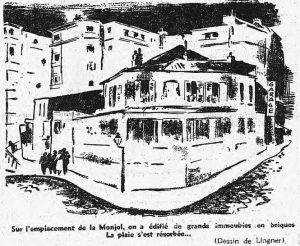
C’est dans ces sortes d’étables que parfois un homme entrait furtivement, triste comme elles. La fille fermait la porte de bois plein.
En haut de l’escalier, sur l’emplacement du fort rasé, était une sorte de terre-plein raviné, bouleversé, cerné de maisons rabougries et crasseuses. Près d’un mur, des roulottes de bohémiens ont échoué qui ne routeront plus. Une eau savonneuse coûte entre les pavés. Des linges sèchent aux fenêtres.
M. Jacques Roberti, dans son livre connu :
Maisons de société, décrit excellemment ce milieu sordide où échouent les prostituées décrépites, chassées des bouges à lanternes. (Le poète Louis de Gonzague-Frick et ses amis de l’école du Lunain parcoururent ces lieux voisins de la place du Combat à l’époque où l’auteur de
Sous le bélier de Bellone était du quartier.)
« Je suis revenu à la Monjol, écrit l’historien documenté des filles. J’ai hanté ses cabarets où s’élèvent parfois des chants désespérés et j’ai connu les prostituées, assises sur les marches de pierre de leurs seuils, comme sur les dalles d’un cimetière. Elles sont là une cinquantaine, réparties en deux équipes. La première équipe « travaille » de cinq heures à neuf heures du matin et de huit heures du soir à minuit. Ce sont les plus vieilles, les plus décrépites. Pendant le jour, elles cèdent leurs chambres à des compagnes un peu moins flétries. La prostitution a ses relèves à la Monjol. »
Les principaux proxénètes de la Monjol étaient les patrons des cabarets et des deux ou trois hôtels misérables de ce coin, dont l’un s’appelait « Hôtel des 56 Marches », un autre, du « Bel Air ». D’autres louaient également des cases, des bicoques, des débarras aux malheureuses « marchandes d’amour ».

La Monjol, la nuit, prenait un aspect effrayant et sinistre. La flamme des lampes à pétrole, glissant par les portes entr’ouvertes, zébrait de larges raies jaunes les ruelles obscures.
Poussées par quelque fringale inassouvie, des ombres se glissaient dans l’inquiétant coupe-gorge. Les coups de sifflet trouaient le silence, suivis de fuites éperdues.
L’écrivain Marius Boisson, qui vécut ses premières années dans une maisonnette sans étage et à toit pointu de ce singulier quartier, a enregistré plus d’un trait de mœurs et plus d’un souvenir coloré. C’est ainsi qu’il vit, un soir de juin 1896 (ou 97) un homme jaillissant d’un coin obscur, tenant une sorte de cuvette de zinc : le malheureux, qui avait été éventré, perdait son sang à flots.
C’étaient là, on en conviendra, mauvais lieux à fuir. A la misère indicible des filles s’ajoutait le honteux trafic des souteneurs qui extorquaient, aux malheureuses la plus grande partie de leur pauvre gain.
Ces déchues exemptes de joie, au terme d’une existence de vicissitudes, rêvaient parfois encore du fond de leur enfer d’idylliques séjours, de tendresses pures, de suaves maternités. Révoltées, contre leurs exploiteurs, les tenanciers de maisons closes, elles disaient à certaines heures plus particulièrement atroces :
« Ils font fortune avec nos ventres et quand on est bien usées ils nous flanquent à la porte. Ah !si on avait un peu de cœur, on irait mettre le feu à toutes les tôles... »
La Monjol, voirie de la prostitution, a cessé de déshonorer ce quartier prolétarien. La pioche des démolisseurs a commencé, au mois de novembre 1926, à porter ses premiers coups dans les bicoques infâmes. Expulsées de leurs cases, vers quels gîtes de fortune sont allées ces malheureuses femmes ? Plusieurs s’en furent rue de la Charbonnière où les tenanciers d’hôtels meublés leur ont accordé le droit de faire le guet, sur le seuil des portes, de cinq à neuf heures du matin. Sur la Monjol dont il ne reste qu’un nom de rue et de vagues traces de son ancienne destination on a édifié de grands immeubles en briques... La plaie s’est résorbée. L’ulcère a disparu.
Fernand Desprês - L’Humanité : journal socialiste quotidien - 19 mai 1937
 Cette sorte de hameau putride était presque entièrement consacré à la prostitution la plus misérable. Des maisons basses, avariées, aux façades de plâtre dartreux, des trottoirs disloqués, des rues en coudes brusques, misérables et malodorantes, à physionomie de repaire ou de coupe-gorge.
Au tournant d’une ruelle lugubre, aux murs troués de portes vétustes, un escalier aux marches craquelées. Au seuil des masures des filles étaient assises, spectrales. D’autres en peignoirs aux couleurs vives, accoudées aux rampes, guettaient avidement le moindre appel du passant. A cette dernière étape de la prostitution, les malheureuses luttent en vain contre les ravages de l’âge et de la maladie qui corrode leurs chairs vénales. Mornes et tristes, visage plâtré et peint, comme certains modèles de Toulouse-Lautrec, ces filles lasses, déjetées, plus ruinées que le fort démantelé qui se dressait autrefois dans ces parages, constituent un triste troupeau, échoué ici par les hasards de la vie. Plus d’une, jadis fille de ferme séduite, ou ouvrière de faubourg victime du chômage, fut à l’origine belle, fraiche, sentimentale. Elles auraient pu devenir des amantes éprises, des ménagères accomplies, des mères de famille sans reproche. Qu’elles aient une part de responsabilité dans leur chute, ou que l’ordre inique des sociétés mérite seul d’être incriminé, le sort de ces malheureuses est pitoyable car elles vivent sans joie d’un triste métier mal rémunéré, dans des réduits au sol écroulé, sans fenêtres, meublés d’un grabat et d’un fourneau.
Cette sorte de hameau putride était presque entièrement consacré à la prostitution la plus misérable. Des maisons basses, avariées, aux façades de plâtre dartreux, des trottoirs disloqués, des rues en coudes brusques, misérables et malodorantes, à physionomie de repaire ou de coupe-gorge.
Au tournant d’une ruelle lugubre, aux murs troués de portes vétustes, un escalier aux marches craquelées. Au seuil des masures des filles étaient assises, spectrales. D’autres en peignoirs aux couleurs vives, accoudées aux rampes, guettaient avidement le moindre appel du passant. A cette dernière étape de la prostitution, les malheureuses luttent en vain contre les ravages de l’âge et de la maladie qui corrode leurs chairs vénales. Mornes et tristes, visage plâtré et peint, comme certains modèles de Toulouse-Lautrec, ces filles lasses, déjetées, plus ruinées que le fort démantelé qui se dressait autrefois dans ces parages, constituent un triste troupeau, échoué ici par les hasards de la vie. Plus d’une, jadis fille de ferme séduite, ou ouvrière de faubourg victime du chômage, fut à l’origine belle, fraiche, sentimentale. Elles auraient pu devenir des amantes éprises, des ménagères accomplies, des mères de famille sans reproche. Qu’elles aient une part de responsabilité dans leur chute, ou que l’ordre inique des sociétés mérite seul d’être incriminé, le sort de ces malheureuses est pitoyable car elles vivent sans joie d’un triste métier mal rémunéré, dans des réduits au sol écroulé, sans fenêtres, meublés d’un grabat et d’un fourneau.
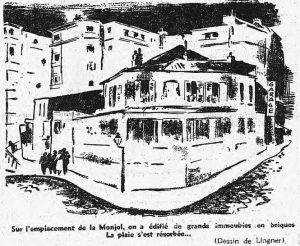 C’est dans ces sortes d’étables que parfois un homme entrait furtivement, triste comme elles. La fille fermait la porte de bois plein.
En haut de l’escalier, sur l’emplacement du fort rasé, était une sorte de terre-plein raviné, bouleversé, cerné de maisons rabougries et crasseuses. Près d’un mur, des roulottes de bohémiens ont échoué qui ne routeront plus. Une eau savonneuse coûte entre les pavés. Des linges sèchent aux fenêtres.
M. Jacques Roberti, dans son livre connu : Maisons de société, décrit excellemment ce milieu sordide où échouent les prostituées décrépites, chassées des bouges à lanternes. (Le poète Louis de Gonzague-Frick et ses amis de l’école du Lunain parcoururent ces lieux voisins de la place du Combat à l’époque où l’auteur de Sous le bélier de Bellone était du quartier.)
« Je suis revenu à la Monjol, écrit l’historien documenté des filles. J’ai hanté ses cabarets où s’élèvent parfois des chants désespérés et j’ai connu les prostituées, assises sur les marches de pierre de leurs seuils, comme sur les dalles d’un cimetière. Elles sont là une cinquantaine, réparties en deux équipes. La première équipe « travaille » de cinq heures à neuf heures du matin et de huit heures du soir à minuit. Ce sont les plus vieilles, les plus décrépites. Pendant le jour, elles cèdent leurs chambres à des compagnes un peu moins flétries. La prostitution a ses relèves à la Monjol. »
Les principaux proxénètes de la Monjol étaient les patrons des cabarets et des deux ou trois hôtels misérables de ce coin, dont l’un s’appelait « Hôtel des 56 Marches », un autre, du « Bel Air ». D’autres louaient également des cases, des bicoques, des débarras aux malheureuses « marchandes d’amour ».
C’est dans ces sortes d’étables que parfois un homme entrait furtivement, triste comme elles. La fille fermait la porte de bois plein.
En haut de l’escalier, sur l’emplacement du fort rasé, était une sorte de terre-plein raviné, bouleversé, cerné de maisons rabougries et crasseuses. Près d’un mur, des roulottes de bohémiens ont échoué qui ne routeront plus. Une eau savonneuse coûte entre les pavés. Des linges sèchent aux fenêtres.
M. Jacques Roberti, dans son livre connu : Maisons de société, décrit excellemment ce milieu sordide où échouent les prostituées décrépites, chassées des bouges à lanternes. (Le poète Louis de Gonzague-Frick et ses amis de l’école du Lunain parcoururent ces lieux voisins de la place du Combat à l’époque où l’auteur de Sous le bélier de Bellone était du quartier.)
« Je suis revenu à la Monjol, écrit l’historien documenté des filles. J’ai hanté ses cabarets où s’élèvent parfois des chants désespérés et j’ai connu les prostituées, assises sur les marches de pierre de leurs seuils, comme sur les dalles d’un cimetière. Elles sont là une cinquantaine, réparties en deux équipes. La première équipe « travaille » de cinq heures à neuf heures du matin et de huit heures du soir à minuit. Ce sont les plus vieilles, les plus décrépites. Pendant le jour, elles cèdent leurs chambres à des compagnes un peu moins flétries. La prostitution a ses relèves à la Monjol. »
Les principaux proxénètes de la Monjol étaient les patrons des cabarets et des deux ou trois hôtels misérables de ce coin, dont l’un s’appelait « Hôtel des 56 Marches », un autre, du « Bel Air ». D’autres louaient également des cases, des bicoques, des débarras aux malheureuses « marchandes d’amour ».
 La Monjol, la nuit, prenait un aspect effrayant et sinistre. La flamme des lampes à pétrole, glissant par les portes entr’ouvertes, zébrait de larges raies jaunes les ruelles obscures.
Poussées par quelque fringale inassouvie, des ombres se glissaient dans l’inquiétant coupe-gorge. Les coups de sifflet trouaient le silence, suivis de fuites éperdues.
L’écrivain Marius Boisson, qui vécut ses premières années dans une maisonnette sans étage et à toit pointu de ce singulier quartier, a enregistré plus d’un trait de mœurs et plus d’un souvenir coloré. C’est ainsi qu’il vit, un soir de juin 1896 (ou 97) un homme jaillissant d’un coin obscur, tenant une sorte de cuvette de zinc : le malheureux, qui avait été éventré, perdait son sang à flots.
C’étaient là, on en conviendra, mauvais lieux à fuir. A la misère indicible des filles s’ajoutait le honteux trafic des souteneurs qui extorquaient, aux malheureuses la plus grande partie de leur pauvre gain.
Ces déchues exemptes de joie, au terme d’une existence de vicissitudes, rêvaient parfois encore du fond de leur enfer d’idylliques séjours, de tendresses pures, de suaves maternités. Révoltées, contre leurs exploiteurs, les tenanciers de maisons closes, elles disaient à certaines heures plus particulièrement atroces :
« Ils font fortune avec nos ventres et quand on est bien usées ils nous flanquent à la porte. Ah !si on avait un peu de cœur, on irait mettre le feu à toutes les tôles... »
La Monjol, voirie de la prostitution, a cessé de déshonorer ce quartier prolétarien. La pioche des démolisseurs a commencé, au mois de novembre 1926, à porter ses premiers coups dans les bicoques infâmes. Expulsées de leurs cases, vers quels gîtes de fortune sont allées ces malheureuses femmes ? Plusieurs s’en furent rue de la Charbonnière où les tenanciers d’hôtels meublés leur ont accordé le droit de faire le guet, sur le seuil des portes, de cinq à neuf heures du matin. Sur la Monjol dont il ne reste qu’un nom de rue et de vagues traces de son ancienne destination on a édifié de grands immeubles en briques... La plaie s’est résorbée. L’ulcère a disparu.
Fernand Desprês - L’Humanité : journal socialiste quotidien - 19 mai 1937
La Monjol, la nuit, prenait un aspect effrayant et sinistre. La flamme des lampes à pétrole, glissant par les portes entr’ouvertes, zébrait de larges raies jaunes les ruelles obscures.
Poussées par quelque fringale inassouvie, des ombres se glissaient dans l’inquiétant coupe-gorge. Les coups de sifflet trouaient le silence, suivis de fuites éperdues.
L’écrivain Marius Boisson, qui vécut ses premières années dans une maisonnette sans étage et à toit pointu de ce singulier quartier, a enregistré plus d’un trait de mœurs et plus d’un souvenir coloré. C’est ainsi qu’il vit, un soir de juin 1896 (ou 97) un homme jaillissant d’un coin obscur, tenant une sorte de cuvette de zinc : le malheureux, qui avait été éventré, perdait son sang à flots.
C’étaient là, on en conviendra, mauvais lieux à fuir. A la misère indicible des filles s’ajoutait le honteux trafic des souteneurs qui extorquaient, aux malheureuses la plus grande partie de leur pauvre gain.
Ces déchues exemptes de joie, au terme d’une existence de vicissitudes, rêvaient parfois encore du fond de leur enfer d’idylliques séjours, de tendresses pures, de suaves maternités. Révoltées, contre leurs exploiteurs, les tenanciers de maisons closes, elles disaient à certaines heures plus particulièrement atroces :
« Ils font fortune avec nos ventres et quand on est bien usées ils nous flanquent à la porte. Ah !si on avait un peu de cœur, on irait mettre le feu à toutes les tôles... »
La Monjol, voirie de la prostitution, a cessé de déshonorer ce quartier prolétarien. La pioche des démolisseurs a commencé, au mois de novembre 1926, à porter ses premiers coups dans les bicoques infâmes. Expulsées de leurs cases, vers quels gîtes de fortune sont allées ces malheureuses femmes ? Plusieurs s’en furent rue de la Charbonnière où les tenanciers d’hôtels meublés leur ont accordé le droit de faire le guet, sur le seuil des portes, de cinq à neuf heures du matin. Sur la Monjol dont il ne reste qu’un nom de rue et de vagues traces de son ancienne destination on a édifié de grands immeubles en briques... La plaie s’est résorbée. L’ulcère a disparu.
Fernand Desprês - L’Humanité : journal socialiste quotidien - 19 mai 1937


